
| Données Personnelles | Thématiques de recherche | Charges de cours | Publications |
MAA Anissa

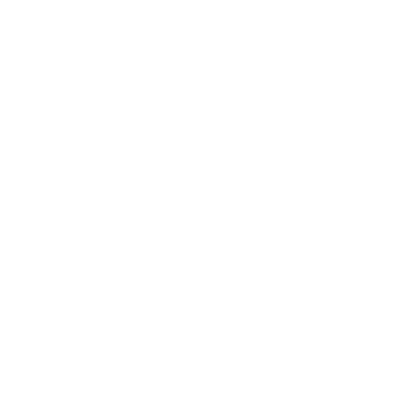
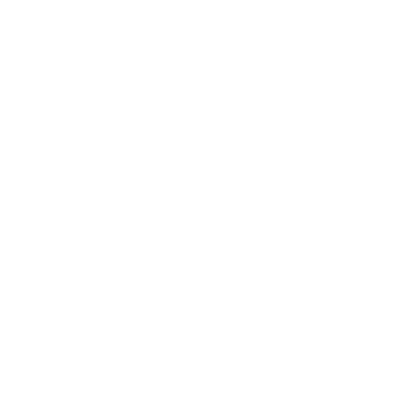
Unités
REPI Recherche et Études en Politique Internationale
Le REPI est une unité de recherche dont les activités principales sont dédiées à la recherche et à l'enseignement en politique internationale à l'Université libre de Bruxelles. Il est rattaché à la Faculté de Philosophie et Sciences sociales et entend poursuivre les activités entreprises par le Réseau d'Études en Politique Internationale auquel il succède. Il promeut des activités de recherche fondamentale entreprises dans le domaine des relations internationales. Il vise à garantir un encadrement de qualité pour la production scientifique dans ce domaine particulier de la science politique (thèses de doctorat, publications, organisations de séminaires et de colloques...). En fonction de ses ressources disponibles, le REPI peut également être sollicité pour des expertises et des consultations auprès d'institutions nationales ou internationales. Il oeuvre à la diffusion des connaissances sur les sujets de politique internationale auprès du grand public. Il est conçu comme un lieu de réflexion sur les enseignements dispensés dans le cadre du Master en relations internationales organisé par le Département de science politique. L'organisation de formations spécifiques et autofinancées (écoles d'été, Executive Master) fait également partie de ses tâches. Ses activités scientifiques se concentrent principalement dans deux domaines importants de la politique internationale : l’étude des questions de sécurité et les politiques publiques internationales (environnement, santé, économie internationale, développement, …). Elles se rattachent à plusieurs traditions de recherche et écoles de pensée : étude des processus décisionnels en politique étrangère (foreign policy analysis), sociologie politique de l’international, approches critiques de la sécurité, économie politique internationale, etc. ; l’objectif étant de saisir au mieux les enjeux de pouvoir dans les relations internationales et ce à différents niveaux. Sont également inclus dans l’agenda de recherche l’étude de l’action extérieure de l’Union européenne et des principales institutions internationales. Directeur : Christian Olsson
Groupe de Recherche sur les relations Ethniques, les Migrations et l'Egalité - GERME
Le GERME est un groupe composé de chercheurs en sciences sociales étudiant les processus d'intégration et d'exclusion dans le contexte des sociétés contemporaines marquées par des inégalités sociales. A l'origine, les activités de recherche du GERME étaient focalisées sur le racisme, les migrations, l'exclusion et l'ethnicité. A présent, les chercheurs s'intéressent à de nombreux domaines, tels que: les pratiques de citoyenneté, le multiculturalisme, la politique d'intégration des migrants, la politique urbaine, les relations de genre, la xénophobie, l'intégration sur le marché du travail, l'éducation, la culture, la religion, la participation politique, les réseaux sociaux et la stratification sociale. Le GERME s'efforce d'examiner tant les réponses de l'État à la diversité ethnique que les inégalités sociales, les expériences vécues par les citoyens des différentes classes sociales, et la mobilisation sociale et politique des groupes sociaux marginalisés ou non. Nous portons un intérêt particulier à l'étude de la société belge (Bruxelles, Wallonie et Flandre), ainsi qu'aux comparaisons internationales.Les chercheurs du GERME mobilisent autant les méthodes qualitatives que quantitatives ainsi que des approches méthodologiques mixtes. Ils développent également une expertise méthodologique cherchant à dépasser les défis de l'approche ethnographique et des études de cas sous la forme d'analyses statistiques multi-variées avancées.Les chercheurs du GERME étudient également les interactions entre la gestion de la diversité culturelle liée aux phénomènes d'immigration d'une part et la lutte de pouvoir entre les groupes linguistiques dominants en Belgique, d'autre part.
Projets
Ce projet de recherche postdoctorale s’intéresse à une transformation majeure du gouvernement international des migrations sur le continent africain : la participation des migrants de retour (ou « retournés ») au contrôle migratoire dans leurs pays d’origine. Non plus des « héros du retour » incitant les jeunes génération à se réaliser en migration, ni même des « ratés de l’aventure » constituant un fardeau pour les communautés d’origine, les retournés sont de plus en plus encouragés à s’investir dans des initiatives qui visent au renforcement du contrôle migratoire depuis leur pays d’origine, qu’il s’agisse de campagnes de sensibilisation contre la migration irrégulière ou de programmes d’assistance et de réintégration en direction de leurs pairs. Dans quelle mesure la participation des retournés au contrôle migratoire transforme-t-elle leur rapport à la mobilité ? Conduit-elle à leur incorporation d’imaginaires de l’immobilité ? Ou opère-t-elle comme une ressource dans la définition de stratégies de réintégration ou de migration ? Pour répondre à ces interrogations, ce projet mobilise et approfondit le concept d’ « intermédiation indigène » élaboré dans le cadre de la thèse de doctorat, lequel permet de saisir l’implication ambigüe des retournés dans le contrôle migratoire. Ces derniers sont en effet susceptibles de se réapproprier leur participation à la lutte contre les migrations irrégulières pour défendre des agendas qui leurs sont propres. Dans ce cadre, le projet de recherche fait l’hypothèse que l’ « intermédiation indigène » assurée par les retournés transforme à la fois l’exercice du contrôle migratoire, leur expérience du retour et leur rapport à la mobilité, ainsi que les relations sociales à l’échelle locale. Il s’appuie sur des terrains de recherche ethnographique menés dans une perspective comparative au Sénégal et au Mali.

