
| Données Personnelles | Thématiques de recherche | Charges de cours | Publications |
SULIMAN JABARY Omar

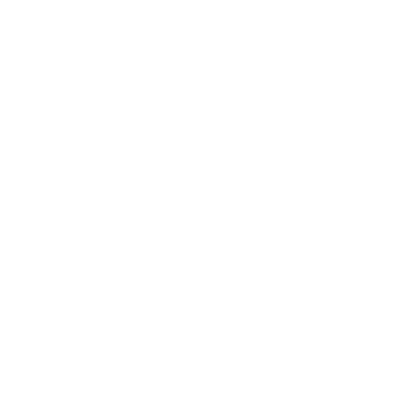
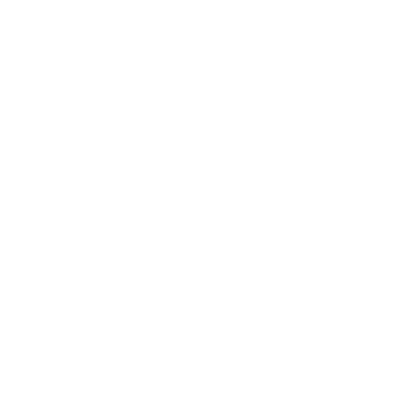
Unités
REPI Recherche et Études en Politique Internationale
Le REPI est une unité de recherche dont les activités principales sont dédiées à la recherche et à l'enseignement en politique internationale à l'Université libre de Bruxelles. Il est rattaché à la Faculté de Philosophie et Sciences sociales et entend poursuivre les activités entreprises par le Réseau d'Études en Politique Internationale auquel il succède. Il promeut des activités de recherche fondamentale entreprises dans le domaine des relations internationales. Il vise à garantir un encadrement de qualité pour la production scientifique dans ce domaine particulier de la science politique (thèses de doctorat, publications, organisations de séminaires et de colloques...). En fonction de ses ressources disponibles, le REPI peut également être sollicité pour des expertises et des consultations auprès d'institutions nationales ou internationales. Il oeuvre à la diffusion des connaissances sur les sujets de politique internationale auprès du grand public. Il est conçu comme un lieu de réflexion sur les enseignements dispensés dans le cadre du Master en relations internationales organisé par le Département de science politique. L'organisation de formations spécifiques et autofinancées (écoles d'été, Executive Master) fait également partie de ses tâches. Ses activités scientifiques se concentrent principalement dans deux domaines importants de la politique internationale : l’étude des questions de sécurité et les politiques publiques internationales (environnement, santé, économie internationale, développement, …). Elles se rattachent à plusieurs traditions de recherche et écoles de pensée : étude des processus décisionnels en politique étrangère (foreign policy analysis), sociologie politique de l’international, approches critiques de la sécurité, économie politique internationale, etc. ; l’objectif étant de saisir au mieux les enjeux de pouvoir dans les relations internationales et ce à différents niveaux. Sont également inclus dans l’agenda de recherche l’étude de l’action extérieure de l’Union européenne et des principales institutions internationales. Directeur : Christian Olsson
Projets
Électrique: la matérialité du pouvoir en Palestine-Israël
Après un changement de discours à la fin du vingtième siècle, la matérialité redevient un objet de fascination. En définitive, les questions matérielles comptent dans l’étude du paysage sociopolitique contemporain. Dans le cadre de cet intérêt renouvelé pour la matérialité, les infrastructures prennent le devant de la scène, et au premier chef l’électricité, infrastructure par excellence du monde moderne. Puisant dans les disciplines de l’urbanisme, de l’économie politique, du colonialisme et des études sur le Moyen-Orient, ce projet se penche, par une analyse approfondie, sur les dimensions sociale, politique, économique et territoriale de l’électrification en Palestine/Israël. Le projet étudie d’un point de vue historique et ethnographique les pratiques, les discours et les acteurs qui transforment l’électricité en un instrument de gouvernance et de pouvoir et exploitent à des fins politiques les infrastructures au service du colonialisme, de la modernité, de la politique intérieure et du développement dans ce contexte particulier. L’analyse vise à développer une conceptualisation de l’électricité qui transcende les frontières entre la technologie et la société, le matériel et le symbolique et l’humain et le non-humain; à combler les lacunes théoriques et empiriques de la recherche en sciences sociales sur l’électricité et l’électrification dans le contexte des colonies; et à proposer une relecture de l’histoire de la région. D’une part, l’approche utilisée met en évidence l’importance historique et politique de l’électricité dans le maintien et la remise en question de l’ordre social et, d’autre part, elle propose une relecture du conflit Palestine-Israël, généralement défini en termes géopolitique et de violence, en mettant l’accent sur les aspects pouvant sembler banals et qui pourtant relient (quoique de manière sélective) les lieux et les populations autrement profondément divisés.

